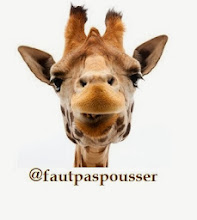C’est pourquoi, en cette enceinte, je ressens le devoir de rappeler l’importance de l’apport et de la responsabilité de l’Europe dans ledéveloppement culturel de l’humanité. Je voudrais le faire en partant d’une image que j’emprunte à un poète italien du XXème siècle, Clemente Rebora, qui, dans l’une de ses poésies, décrit un peuplier, avec ses branches élevées vers le ciel et agitées par le vent, son tronc solide et ferme, ainsi que ses racines profondes qui s’enfoncent dans la terre
. En un certain sens, nous pouvons penser à l’Europe à la lumière de cette image.
Au cours de son histoire, elle a toujours tendu vers le haut, vers des objectifs nouveaux et ambitieux, animée par un désir insatiable de connaissance, de développement, de progrès, de paix et d’unité. Mais l’élévation de la pensée, de la culture, des découvertes scientifiques est possible seulement à cause de la solidité du tronc et de la profondeur des racines qui l’alimentent. Si les racines se perdent, lentement le tronc se vide et meurt et les branches – autrefois vigoureuses et droites – se plient vers la terre et tombent. Ici, se trouve peut-être l’un des paradoxes les plus incompréhensibles pour une mentalité scientifique qui s’isole : pour marcher vers l’avenir, il faut le passé, de profondes racines sont nécessaires et il faut aussi le courage de ne pas se cacher face au présent et à ses défis. Il faut de la mémoire, du courage, une utopie saine et humaine.
D’autre part – fait observer Rebora – « le tronc s’enfonce là où il y a davantage de vrai »
[8]. Les racines s’aliment de la vérité, qui constitue la nourriture, la sève vitale de n’importe quelle société qui désire être vraiment libre, humaine et solidaire. En outre, la vérité fait appel à la conscience, qui est irréductible aux conditionnements, et pour cela est capable de connaître sa propre dignité et de s’ouvrir à l’absolu, en devenant source des choix fondamentaux guidés par la recherche du bien pour les autres et pour soi et lieu d’une liberté responsable
[9].
Il faut en suite garder bien présent à l’esprit que sans cette recherche de la vérité, chacun devient la mesure de soi-même et de son propre agir, ouvrant la voie à l’affirmation subjective des droits, de sorte qu’à la conception de droit humain, qui a en soi une portée universelle, se substitue l’idée de droit individualiste. Cela conduit à être foncièrement insouciant des autres et à favoriser la globalisation de l’indifférence qui naît de l’égoïsme, fruit d’une conception de l’homme incapable d’accueillir la vérité et de vivre une authentique dimension sociale.
Un tel individualisme rend humainement pauvre et culturellement stérile, parce qu’il rompt de fait les racines fécondes sur lesquelles se greffe l’arbre. De l’individualisme indifférent naît le culte de l’opulence, auquel correspond la culture de déchet dans laquelle nous sommes immergés. Nous avons, de fait, trop de choses, qui souvent ne servent pas, mais nous ne sommes plus en mesure de construire d’authentiques relations humaines, empreintes de vérité et de respect mutuel. Ainsi, aujourd’hui nous avons devant les yeux l’image d’une Europe blessée, à cause des nombreuses épreuves du passé, mais aussi à cause des crises actuelles, qu’elle ne semble plus capable d’affronter avec la vitalité et l’énergie d’autrefois. Une Europe un peu fatiguée, pessimiste, qui se sent assiégée par les nouveautés provenant d’autres continents.
À l’Europe, nous pouvons demander : où est ta vigueur ? Où est cette tension vers un idéal qui a animé ton histoire et l’a rendue grande? Où est ton esprit d’entreprise et de curiosité ? Où est ta soif de vérité, que jusqu’à présent tu as communiquée au monde avec passion ?
De la réponse à ces questions, dépendra l’avenir du continent. D’autre part – pour revenir à l’image de Rebora – un tronc sans racines peut continuer d’avoir une apparence de vie, mais à l’intérieur il se vide et meurt. L’Europe doit réfléchir pour savoir si son immense patrimoine humain, artistique, technique, social, politique, économique et religieux est un simple héritage de musée du passé, ou bien si elle est encore capable d’inspirer la culture et d’ouvrir ses trésors à l’humanité entière. Dans la réponse à cette interrogation, le Conseil de l’Europe avec ses institutions a un rôle de première importance.
Je pense particulièrement au rôle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui constitue en quelque sorte la ‘‘conscience’’ de l’Europe pour le respect des droits humains. Je souhaite que cette conscience murisse toujours plus, non par un simple consensus entre les parties, mais comme fruit de la tension vers ces racines profondes, qui constituent les fondements sur lesquels les Pères fondateurs de l’Europe contemporaine ont choisi de construire.
Avec les racines – qu’il faut chercher, trouver et maintenir vivantes par l’exercice quotidien de la mémoire, puisqu’elles constituent le patrimoine génétique de l’Europe – il y a les défis actuels du continent qui nous obligent à une créativité continue, pour que ces racines soient fécondes aujourd’hui et se projettent vers des utopies de l’avenir. Je me permets d’en mentionner seulement deux : le défi de la multipolarité et le défi de la transversalité.
L’histoire de l’Europe peut nous amener à concevoir celle-ci naïvement comme une bipolarité, ou tout au plus comme une tripolarité(pensons à l’antique conception : Rome – Byzance – Moscou), et à nous mouvoir à l’intérieur de ce schéma, fruit de réductionnismes géopolitiques hégémoniques, dans l’interprétation du présent et dans la projection vers l’utopie de l’avenir.
Aujourd’hui, les choses ne se présentent pas ainsi et nous pouvons légitimement parler d’une Europe multipolaire. Les tensions – aussi bien celles qui construisent que celles qui détruisent – se produisent entre de multiples pôles culturels, religieux et politiques. L’Europe aujourd’hui affronte le défi de «globaliser» mais de manière originale cette multipolarité. Les cultures ne s’identifient pas nécessairement avec les pays : certains d’entre eux ont diverses cultures et certaines cultures s’expriment dans divers pays. Il en est de même des expressions politiques, religieuses et associatives.
Globaliser de manière originale – je souligne cela : de manière originale – la multipolarité comporte le défi d’une harmonie constructive, libérée d’hégémonies qui, bien qu’elles semblent pragmatiquement faciliter le chemin, finissent par détruire l’originalité culturelle et religieuse des peuples.
Parler de la multipolarité européenne signifie parler de peuples qui naissent, croissent et se projettent vers l’avenir. La tâche de globaliser la multipolarité de l’Europe, nous ne pouvons pas l’imaginer avec l’image de la sphère – dans laquelle tout est égal et ordonné, mais qui en définitive est réductrice puisque chaque point est équidistant du centre – mais plutôt avec celle du polyèdre, où l’unité harmonique du tout conserve la particularité de chacune des parties. Aujourd’hui, l’Europe est multipolaire dans ses relations et ses tensions ; on ne peut ni penser ni construire l’Europe sans assumer à fond cette réalité multipolaire.
L’autre défi que je voudrais mentionner est la transversalité. Je pars d’une expérience personnelle : dans les rencontres avec les politiciens de divers pays de l’Europe, j’ai pu remarquer que les politiciens jeunes affrontent la réalité avec une perspective différente par rapport à leurs collègues plus adultes. Ils disent peut-être des choses apparemment similaires, mais l’approche est différente. Les paroles sont semblables, mais la musique est différente. Cela s’observe chez les jeunes politiciens des divers partis. Cette donnée empirique indique une réalité de l’Europe contemporaine que l’on ne peut ignorer sur le chemin de la consolidation continentale et de sa projection future : tenir compte de cette transversalité qui se retrouve dans tous les domaines. Cela ne peut se faire sans recourir au dialogue, même inter-générationnel. Si nous voulions définir aujourd’hui le continent, nous devrions parler d’une Europe en dialogue, qui fait en sorte que la transversalité d’opinions et de réflexions soit au service des peuples unis dans l’harmonie.
Emprunter ce chemin de communication transversale comporte non seulement une empathie générationnelle mais aussi une méthodologie historique de croissance. Dans le monde politique actuel de l’Europe, le dialogue uniquement interne aux organismes (politiques, religieux, culturels) de sa propre appartenance se révèle stérile. L’histoire aujourd’hui demande pour la rencontre, la capacité de sortir des structures qui « contiennent » sa propre identité afin de la rendre plus forte et plus féconde dans la confrontation fraternelle de la transversalité. Une Europe qui dialogue seulement entre ses groupes d’appartenance fermés reste à mi-chemin ; on a besoin de l’esprit de jeunesse qui accepte le défi de la transversalité.
Dans cette perspective, j’accueille positivement la volonté du Conseil de l’Europe d’investir dans le dialogue inter-culturel, y compris dans sa dimension religieuse, par les Rencontres sur la dimension religieuse du dialogue interculturel. Il s’agit d’une occasion propice pour un échange ouvert, respectueux et enrichissant entre personnes et groupes de diverses origine, tradition ethnique, linguistique et religieuse, dans un esprit de compréhension et de respect mutuel.
Ces rencontres semblent particulièrement importantes dans le contexte actuel multiculturel, multipolaire, à la recherche de son propre visage pour conjuguer avec sagesse l’identité européenne formée à travers les siècles avec les instances provenant des autres peuples qui se manifestent à présent sur le continent.
C’est dans cette logique qu’il faut comprendre l’apport que le christianisme peut fournir aujourd’hui au développement culturel et social européen dans le cadre d’une relation correcte entre religion et société. Dans la vision chrétienne, raison et foi, religion et société sont appelées à s’éclairer réciproquement, en se soutenant mutuellement et, si nécessaire, en se purifiant les unes les autres des extrémismes idéologiques dans lesquelles elles peuvent tomber. La société européenne tout entière ne peut que tirer profit d’un lien renouvelé entre les deux domaines, soit pour faire face à un fondamentalisme religieux qui est surtout ennemi de Dieu, soit pour remédier à une raison « réduite », qui ne fait pas honneur à l’homme.
Les thèmes d’actualité, dans lesquels je suis convaincu qu’il peut y avoir un enrichissement mutuel, où l’Église catholique – particulièrement à travers le Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe (CCEE) – peut collaborer avec le Conseil de l’Europe et offrir une contribution fondamentale, sont très nombreux. Avant tout, à la lumière de tout ce que je viens de dire, il y a le domaine d’une réflexion éthique sur les droits humains, sur lesquels votre Organisation est souvent appelée à se pencher. Je pense particulièrement aux thèmes liés à la protection de la vie humaine, questions délicates qui ont besoin d’être soumises à un examen attentif, qui tienne compte de la vérité de tout l’être humain, sans se limiter à des domaines spécifiques médicaux, scientifiques ou juridiques.
De même, ils sont nombreux, les défis du monde contemporains qui requièrent une étude et un engagement commun, à commencer par l’accueil des migrants, qui ont besoin d’abord et avant tout de l’essentiel pour vivre, mais principalement que leur dignité de personnes soit reconnue. Il y a ensuite le grave problème du travail, surtout en ce qui concerne les niveaux élevés de chômage des jeunes dans beaucoup de pays – une vraie hypothèque pour l’avenir – mais aussi pour la question de la dignité du travail.
Je souhaite vivement que s’instaure une nouvelle collaboration sociale et économique, affranchie de conditionnements idéologiques, qui sache faire face au monde globalisé, en maintenant vivant ce sens de solidarité et de charité réciproques qui a tant caractérisé le visage de l’Europe grâce à l’action généreuse de centaines d’hommes et de femmes – dont certains sont considérés saints par l’Église catholique – qui, au cours des siècles, se sont dépensés pour développer le continent, tant à travers l’activité d’entreprise qu’à travers des œuvres éducatives, d’assistance et de promotion humaine. Surtout ces dernières représentent un point de référence important pour les nombreux pauvres qui vivent en Europe. Combien il y en a dans nos rues ! Ils demandent non seulement le pain pour survivre, ce qui est le plus élémentaire des droits, mais ils demandent aussi à redécouvrir la valeur de leur propre vie, que la pauvreté tend à faire oublier, et à retrouver la dignité conférée par le travail.
Enfin, parmi les thèmes qui sollicitent notre réflexion et notre collaboration, il y a la protection de l’environnement, de notre bien-aimée Terre qui est la grande ressource que Dieu nous a donnée et qui est à notre disposition non pour être défigurée, exploitée et avilie, mais pour que nous puissions y vivre avec dignité, en jouissant de son immense beauté.
Monsieur le Secrétaire, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs,
Le bienheureux
Paul VI a défini l’Église « experte en humanité »
[10]. Dans le monde, à l’imitation du Christ, malgré les péchés de ses enfants, elle ne cherche rien d’autre que de servir et de rendre témoignage à la vérité
[11]. Rien d’autre que cet esprit ne nous guide dans le soutien du chemin de l’humanité.
Avec cette disposition d’esprit, le Saint-Siège entend continuer sa propre collaboration avec le Conseil de l’Europe, qui revêt aujourd’hui un rôle fondamental pour forger la mentalité des futures générations d’Européens. Il s’agit d’effectuer ensemble une réflexion dans tous les domaines, afin que s’instaure une sorte de « nouvelle agorà », dans laquelle chaque instance civile et religieuse puisse librement se confronter avec les autres, même dans la séparation des domaines et dans la diversité des positions, animée exclusivement par le désir de vérité et par celui d’édifier le bien commun. La culture, en effet, naît toujours de la rencontre réciproque, destinée à stimuler la richesse intellectuelle et la créativité de ceux qui y prennent part ; et cela, outre le fait que c’est la réalisation du bien, cela est beauté. Je souhaite que l’Europe, en redécouvrant son patrimoine historique et la profondeur de ses racines, en assumant sa vivante multipolarité et le phénomène de la transversalité en dialogue, retrouve cette jeunesse d’esprit qui l’a rendue féconde et grande.
Merci !
1 [
↩] Cf.
Evangelii gaudium, n. 223
2 [
↩] Paul VI,
Message pour la VIIIe Journée Mondiale de la Paix, 8 décembre 1974.
3 [
↩] Ibid.
4 [
↩] Cf.
Evangelii gaudium, n. 226.
5 [
↩] Catéchisme de l’Église Catholique, n. 2329 et
Gaudium et spes n. 81.
6 [
↩] Jean-Paul II,
Message pour la XVe Journée Mondiale de la Paix, 8 décembre 1981, n. 4.
7 [
↩] “Vibra nel vento con tutte le sue foglie / il pioppo severo; / spasima l’aria in tutte le sue doglie / nell’ansia del pensiero: / dal tronco in rami per fronde si esprime / tutte al ciel tese con raccolte cime: / fermo rimane il tronco del mistero, / e il tronco s’inabissa ov’è più vero”, Il pioppo in :
Canti dell’Infermità, ed. Vanni Scheiwiller, Milano 1957, 32.
8 [
↩] Ibid.
9 [
↩] Cf. Jean-Paul II,
Discours à l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 8 octobre 1988, n. 4.
10 [
↩] Lett. Enc.
Populorum progressio, n. 13.
11 [
↩] Cf. ibid.
Retour lexique haut de page[
↩]
***********************

Audio sur RCF:
Retour lexique haut de page[
↩]
Avec
Grégor PUPPINCK, juriste, directeur du CEJD , Centre Européen pour la justice et les droits fondamentaux de la personne humaine.


Grégor Puppinck : « Le pape François est dans la continuité avec les autres papes »
« Je note que le pape ainsi que ses discours ont été très bien bien accueillis. Celui devant le Conseil de l'Europe était centré sur la paix. Il défendait l'idée d'une Europe multipolaire, un concept que ses prédécesseurs n'avaient pas beaucoup développé. Le discours devant le Parlement européen était plus « global » et m'a semblé particulièrement riche, même s'il a peu insisté sur les questions de société. L'élément central était sa critique de l'individualisme et de la« culture du déchet ».
Le Pape a parlé d'un Occident en crise, où l'on a absolutisé l'individu, la technique et l'économie. Un individualisme qui conduit notamment à la solitude, un véritable fléau. A juste titre, le pape a suggéré qu'il faudrait réhumaniser l'Europe et replacer la personne humaine dans le contexte social. A mon avis, le pape François est dans une continuité avec les autres papes des XXe et XXIe siècles. Comme eux, Il s'inscrit dans la défense du projet européen. Et comme eux, il a mis en avant l'importance de garder les racines chrétiennes vivantes. »
 (par Gregor puppink)
(par Gregor puppink)
Un sermon sans précédent a eu lieu le 25 novembre à Strasbourg, prononcé non pas au sein de la fameuse cathédrale gothique, mais devant les tribunes les plus mondaines d’Europe. C’est la première fois qu’un Pape non européen prend la parole devant les institutions européennes.
Les interventions du Pontife devant le Parlement européen et le Conseil de l’Europe étaient, bien entendu, plus politiques que pastorales. C’est la raison pour laquelle certains sceptiques, à l’instar de Jean-Luc Mélenchon, considèrent que le déplacement du Pape François, ainsi que ses deux discours violent la laïcité. Nous avons demandé à notre interlocuteur Grégor Puppinck, directeur du Centre Européen pour les droits de l'homme et la justice, qui a assisté à deux interventions du vicaire du Christ, de démythifier les « motifs » du Saint-Père et d’analyser son discours.
Grégor Puppinck.Pourquoi cette visite ? Cela fait plusieurs années que les institutions européennes, le Parlement européen et, en particulier, le Conseil de l’Europe, ont invité le Saint-Père, le Pape, à venir s’adresser aux institutions et au peuple européen. C’est également une tradition que le Pape vienne régulièrement parler, donner et partager sa vision de l’Europe. Je pense qu’aujourd’hui cette visite a un sens particulier parce que l’Europe a fait un virage, elle est sur le point critique de son histoire avec une concomitance de plusieurs crises actuelles : une crise de confiance dans le mécanisme européen, dans le processus institutionnel et de développement de l’Union européenne. C’est une crise importante parce que nous avons vu les résultats des élections qui ont montré que maintenant, il y a beaucoup de scepticisme à l’égard des institutions européennes. Vient ensuite une crise économique très forte, même financière également, il y a beaucoup de chômage, surtout parmi les jeunes. S’y ajoute une crise culturelle : l’Europe ne sait plus très bien quelles sont ses valeurs. Et puis, une crise géopolitique avec le conflit ukrainien qui traverse actuellement l’Europe. Toutes ces crises sont importantes, elles mettent en cause l’avenir du continent européen, de notre civilisation. Lorsque l’Europe est en crise, c’est le moment extrêmement important où l’Eglise catholique peut venir parler pour resituer l’Europe, notre projet politique, notre société dans une perspective beaucoup plus longue afin d’essayer de sortir de cette crise, de voir au-delà des événements à court terme. C’est le moment où l’Eglise peut venir repositionner l’Europe, nous resituer dans le temps long, dans le temps de l’Eglise qui atteint bimillénaires. Dès le départ, l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe ont toujours accompagné l’histoire du continent européen. Donc, lorsque le continent est en crise, il est important que les chrétiens s’adressent et remontrent aux peuples européens quelles sont les vraies valeurs et les priorités. Plus précisément, le sens du message du Pape François était d’essayer de dépasser la crise pour remontrer aux peuples européens quelles sont les vraies valeurs qu’il faut rechercher, qu’il faut poursuivre au-delà des valeurs purement mercantiles et individualistes qui, trop souvent, déterminent notre politique.
La Voix de la Russie.Merci d’avoir présenté les thèmes principaux de l’intervention du Pape. Vous y avez assisté, n’est-ce pas ?
Grégor Puppinck.Oui, j’ai assisté aux interventions. Il y a eu deux interventions : une au Parlement européen, puis l’autre au Conseil de l’Europe. Le Parlement européen, donc c’est l’intervention devant les institutions de l’Europe occidentale, le Pape a beaucoup parlé de la dignité transcendante de la personne humaine. Il a invité les institutions de l’Europe occidentale à refonder notre projet politique non plus sur l’économie, sur les finances ou sur la technologie, mais sur la personne, sur la dignité transcendante de la personne humaine. C’est une question de hiérarchie de valeurs. Trop souvent, la politique européenne est déterminée uniquement par les intérêts économiques et technologiques. Et le Pape a dit : cette approche-là, individualiste, rend stérile notre culture. Il faut réussir à dépasser ces valeurs économiques, financières et techniques en plaçant au-dessus un point de référence bien plus élevé et important qui est issu de la personne humaine et de sa transcendance, c’est-à-dire de la capacité, de la spécificité de la personne humaine qui la distingue de tout le reste qui est à la fois son enracinement dans la réalité et son ouverture au spirituel. Alors, tout le propos du Pape a été de dire : au-dessus de l’économie, au-dessus de la finance, il doit y avoir d’abord la recherche de la protection et de l’affirmation de la dignité transcendante de la personne humaine. C’est uniquement si on refonde notre politique, notre projet politique sur cette dignité qu’elle peut retrouver un sens et être réhumanisée. Finalement, ce que le Pape a dit, c’est que l’Europe souffre aujourd’hui d’être déshumanisée, d’avoir perdu le sens de l’humain. Il faut de nouveau humaniser notre société. Il a beaucoup insisté sur les ravages d’individualisme qui cause énormément de solitude, qui crée un esprit d’exploitation de la personne et qui dénature les droits de l’homme. Il a invité à essayer de recomprendre la société au service de la personne qui est aussi un être social, un être qui fait partie d’une société, d’une communauté et qui doit être appréhendée dans sa totalité.
Par contre, le deuxième discours qu’il a fait devant le Conseil de l’Europe, institution qui regroupe 47 Etats dont, notamment, toute l’Europe centrale, l’Europe orientale, la Russie, l’Ukraine, la Turquie, etc. Le deuxième discours du Pape a été également très important. Il s’est concentré essentiellement sur la paix. Il a rappelé que la finalité du Conseil de l’Europe a toujours été d’être au service de la paix en Europe et qu’aujourd’hui encore cette institution doit maintenir cette œuvre, cette recherche d’instauration de la paix en Europe. Cette paix, il l’a dit, il l’a défendait d’abord, doit être fondée sur une juste compréhension de l’homme et de la société. Mais il a ajouté deux éléments qui me paraissent très importants et nouveaux dans le discours de l’Eglise catholique. L’Europe doit renoncer à une approche purement monolithique, elle ne doit pas chercher à constituer un ensemble politique monolithique mais doit se considérer elle-même comme un ensemble multipolaire. La multipolarité c’est la reconnaissance qu’il peut y avoir légitimement plusieurs centres de pouvoir politique en Europe. Le but n’est pas de construire une Europe uniforme mais de reconnaître que l’Europe est un organisme vivant, est une culture, une société, une civilisation qui a une diversité. Très concrètement, dans le contexte du conflit actuel autour de l’Ukraine, c’est la reconnaissance que chacun dans cette Europe doit avoir sa place, aussi bien la Russie avec sa culture et ses valeurs que l’Europe occidentale. Il ne faut pas chercher à imposer les valeurs de l’un au détriment de l’autre, il ne faut pas chercher à imposer une Europe monolithique, a-t-il dit, mais reconnaître son caractère pluriel, sa multipolarité. Comment ensuite faire vivre une Europe multipolaire ? C’est là la difficulté. Il a précisé : par une approche transversale. Cela veut dire non pas par un pouvoir, un peu comme on voit aujourd’hui qui irait de bas en haut, selon l’approche monolithique, mais une vie politique transversale essentiellement animée par le dialogue entre les peuples, entre les cultures. C’est une approche différente de la situation culturelle et politique européenne qui, au départ, reconnaît la légitimité de la diversité culturelle et de la multiplicité de centres politiques. Pour le Pape, la reconnaissance de cette multipolarité et de la nécessité de vivre dans la transversalité constitue également une condition à la paix en Europe. C’est la volonté d’imposer un pouvoir unique et vertical sous l’ensemble du continent qui est source de conflit. Je pense que c’est un élément important et assez nouveau dans le discours du Saint-Père. Et je crois qu’il faut l’étudier profondément.
LVdlR. Est-ce qu’il s’est également prononcé sur l’Ukraine ?
Grégor Puppinck.Non, il n’a pas parlé précisément de l’Ukraine. Mais, évidemment, lorsqu’il est intervenu au Conseil de l’Europe, la question des conflits politiques qui divisent aujourd’hui l’Europe était en arrière-fond. Je pense que c’est dans le contexte du conflit ukrainien qui oppose, en particulier, l’Union européenne et la Russie que le discours du Pape trouve tout son sens.
LVdlR. Vous savez, sans doute, que certains sceptiques craignent que l’intervention d’une personnalité religieuse comme le Pape devant les institutions politiques puisse porter atteinte contre la laïcité. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Grégor Puppinck.Ceux qui craignent cela sont étroits d’esprit et ne savent pas considérer la réalité dans son intégralité. Le monde est bien plus large que simplement la matière, il faut donc parler aux esprits, savoir que l’homme a aussi un esprit, une spiritualité et que, naturellement, l’homme sans la spiritualité n’est qu’un animal. Je pense que c’est tout à fait légitime et important que le Pape puisse s’exprimer au Parlement européen, au Conseil de l’Europe. Il a été très bien accueilli. Je répète encore une fois, l’histoire des Eglises catholique et orthodoxe accompagne l’histoire européenne. L’Europe a été largement issue, créée par cet héritage à la fois de Rome et d’Athènes. On connaît, bien sûr, Sts. Cyrille et Méthode, le rôle des apôtres, etc. Même aujourd’hui, l’Europe est fondamentalement chrétienne dans sa culture.
LVdlR. Il paraît que vous partagez presqu’entièrement la position du Pape…
Grégor Puppinck.Oui, je suis tout à fait content de cette intervention. Aujourd’hui, je la partage à tous points de vue. Je dois dire que ce sont des interventions très riches, en particulier, au Parlement européen, lorsque le Pape a abordé beaucoup de sujets. Il a parlé des enjeux de la société actuelle, il a également parlé sur le fond, sur la civilisation, il a aussi parlé des questions plus géopolitiques actuelles. Je pense que ce sont deux discours riches et importants. Mais il va falloir un peu de temps pour bien les assimiler. Je crois que les deux discours du Pape donnent une orientation au travail politique des peuples européens. C’est vrai que nous avons besoin aujourd’hui d’une hauteur de vue. Souvent, le problème que nous avons dans les démocraties, c’est que la politique se fait à court terme. Nous avons besoin de personnes capables de voir l’histoire, le destin de notre société sous le long terme, dans la durée. L’Eglise est capable de le faire. Elle cherche avant tout le bien de l’homme, elle ne cherche pas un intérêt particulier politique ou géopolitique. Et nous avons besoin de cette orientation, de cette vision d’avenir pour guider notre action. Je crois que c’est vraiment essentiel et en cela, le Pape a vraiment rendu un grand service aux institutions européennes. J’espère que les institutions européennes sauront l’écouter.
Commentaire.Face au schisme de l’Europe, le Saint-Père semble prétendre à assurer quelques fonctions politiques. Qu’il ait eu l’intention de le faire ou non, il en a le droit. Car pour sauver l’intégralité du continent européen, il faut tout d’abord préserver son héritage de base, son héritage romano-chrétien.
Retour lexique haut de page[
↩]
************************
(Source: News.va)
Discours de Martin Schulz, Président du Parlement européen
Vingt-six ans se sont écoulés depuis le discours de Jean-Paul II au Parlement européen. C’était le 11 octobre 1988. La visite du Pape fut un prélude à l’annus mirabilis de l’Europe: 1989. Jean-Paul II et toute l’Eglise eurent un rôle fondamental dans le processus qui mit un terme au joug soviétique, en soutenant la demande de liberté, d’émancipation et d’indépendance de millions de citoyens de l’Europe centrale et orientale.

En 1988, Jean-Paul II parlait à des députés de douze pays, élus pour représenter 330 millions de citoyens. Le Pape François parlera à des députés européens provenant de vingt-huit pays, qui représentent plus d’un demi-milliard de personnes. L’espérance que Jean-Paul II a contribué à réaliser est aujourd’hui achevée. L’Eglise a toujours soutenu l’Europe dans sa croissance, mais elle a également contribué de manière cruciale à sa réunification.
Mais quelle mission doit accompagner l’Europe dans son avenir? La visite du Pape François aidera à répondre à cette question, à pousser tous les Européens à s’interroger sur le sens le plus profond de notre union. Voulons-nous une Europe qui ne soit qu’un marché uni pour la libre circulation des biens et des capitaux? Ou voulons-nous une Europe qui renouvelle les valeurs de solidarité, tolérance, respect de la personne et égalité, qui ont inspiré ses pères fondateurs?
La visite du Pape François n’est pas une atteinte à la laïcité des institutions européennes. La laïcité ne veut pas dire manque de dialogue. La laïcité ne veut pas dire nier le pluralisme sur lequel l’Europe est fondée. La laïcité signifie autonomie, impartialité, garantie et liberté, non pas introspection.
Les objectifs et les valeurs qui nous unissent sont beaucoup plus forts que les éléments de division. Souvent, nous l’oublions. En tant que maire, en apportant de l’aide aux sans-abris et en accueillant les immigrés, j’ai toujours pu compter sur l’aide de mon diocèse. En tant que président du Parlement européen, je ne peux que reconnaître le rôle de premier plan de l’Eglise en vue de limiter les dégâts, matériels et immatériels, de la crise économique.
La présence à Strasbourg du Pape François, le Pape qui est venu « du bout du monde », peut servir à secouer l’Union du sentiment d’égarement préoccupant qui, au cours des dernières années, a conduit les Européens à chercher des coupables plutôt qu’à identifier des solutions. Nous avons un programme à partager et une voie commune à parcourir. Cette voie doit conduire l’Europe vers ses périphéries, matérielles et immatérielles, géographiques et spirituelles.
L’un des premiers actes publics du Pape François a été sa visite à Lampedusa, à la périphérie de l’Europe, où la solidarité, des Européens et entre les Européens, est fortement mise à l’épreuve. Non seulement les paroles, mais l’histoire même du Pape François devraient nous rappeler que, de même qu’aujourd’hui, l’Europe est un lieu d’immigration, elle a été longtemps un continent d’émigration. Que la solution pour l’avenir est, d’un côté, créer un système d’immigration légale et, de l’autre, accroître les efforts afin que l’accueil des demandeurs d’asile soit une responsabilité partagée.
Mais les paroles du Pape nous rappellent aussi les autres « périphéries » de notre temps: les jeunes exclus du monde du travail et de la perspective d’un avenir digne, les personnes âgées qui sont laissées seules et considérées comme un poids pour les familles et la société, les chômeurs qui à long terme, sont inexorablement éloignés du monde du travail, les familles qui sont repoussées aux marges des villes et n’ont pas accès aux services sociaux. Nos périphéries sont complexes, isolées et peu accueillantes. Pour les transformer, nous avons besoin d’énergie, de temps, d’imagination et d’unité.
Nous avons embrassé la mondialisation, non pas pour nous laisser emporter par elle, mais pour la rendre humaine, sociale et durable. Nous avons embrassé l’Europe, non pas pour défendre nos conquêtes derrière un mur, mais afin que toujours plus de personnes puissent jouir des mêmes droits que nous.
Je remercie le Pape François pour sa visite au Parlement européen et au Conseil de l’Europe, je suis certain qu’il contribuera à réveiller la vieille Europe de sa torpeur et à la reconduire au milieu de ses populations et ses périphéries.
Martin Schulz, Président du Parlement européen
Retour lexique haut de page[
↩]