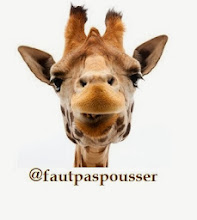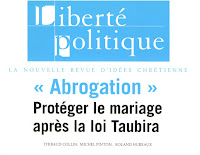"La libération du mariage religieux"
Claude de Martel & Anne Morinneaux de Martel - IF&R
Résumé
La loi du 77 mai 2013 a soulevé bien des interrogations de conscience. Il est apparu qu'elle s'adressait davantage à une minorité qu'à l'ensemble de nos concitoyens. Les rejets provoqués par cette loi auraient été bien atténués si le Parlement avait en même temps permis aux couples de célébrer leur union selon leurs propres convictions religieuses.
À l'instar de ce qui se passe dans de nombreux autres pays, authentiquement libéraux, il est urgent que la France admette la validité civile des mariages célébrés religieusement. En s'appuyant sur la convention de New York de 1962 sur le mariage, l'auteur formule des propositions concrètes pour réaliser cette réforme.
Les commentateurs, qu'ils soient pro ou anti- « mariage pour tous », s'accordent pour déclarer que la loi du 17 mai 2013, et ses semblables à travers le monde, ont bouleversé le mariage : « Traditionnellement, le mariage est défini comme l'union de l'homme et de la femme. Tel est l'héritage des siècles et des millénaires, tel est l'un des fondements de notre histoire et de notre culture »' - un ancrage immémorial dans l'histoire de l'humanité, et qui a été, de surcroît, longtemps marqué par une très forte imprégnation des croyances religieuses.
De ce passé, l'historien de demain constatera peut-être qu'une vingtaine d'années (le mouvement a commencé aux Pays-Bas en 2000) auront suffi pour faire table rase. Et il s'étonnera de la facilité avec laquelle, à quelques exceptions près, les choses se sont déroulées.
La cause principale de cette victoire éclair est bien connue. Le coup de force des partisans du mariage entre personnes de même sexe s'est déroulé sur fond de confusion extrême concernant la définition du mariage, ses formes, ses effets. Alors que la poussée apparemment irrésistible de l'individualisme, de l'égalitarisme, du consumérisme et du laïcisme dans les pays riches de la planète aurait dû conduire - et avait, en fait, déjà largement conduit - à une dilution du mariage dans un conglomérat de types d'unions et de familles dépourvus de toute dimension religieuse et plus ou moins indifférenciés sur les plans juridique, fiscal, social, la soudaine assomption du mariage entre personnes de même sexe a fait resurgir des questions qui étaient progressivement sorties de la sphère d'intérêt des médias, des responsables politiques, des juges et des professeurs de droit. D'où l'impression, parmi tous les observateurs de bonne foi, sinon d'une absence de débats, au moins d'une très grande insuffisance des débats autour de cette sorte de mariage proprement révolutionnaire. De sorte qu'aujourd'hui, personne ne peut trancher entre ceux qui voient dans le mariage entre personnes de même sexe une planche de salut pour le mariage et ceux qui y voient son acte de décès.
Mais l'historien du futur évoqué ci-dessus discernera sans peine un autre phénomène qui semble échapper à la plupart des observateurs de notre époque : le fait que les destructeurs du mariage traditionnel ont laissé subsister, dans la plupart des pays où ils ont sévi, des poches de résistance constituées par des formes de mariage alternatives au mariage civil. Malgré leur enthousiasme révolutionnaire, ils n'ont pas osé insulter définitivement l'avenir. De cela, au moins, les générations futures leur sauront gré à coup sûr. Sauf dans quatre pays européens qui, devant le tribunal de cette histoire, risquent de se trouver en mauvaise posture : la Belgique, la France, le Luxembourg et la Roumanie. On l'aura deviné : ce sont quatre États qui ont introduit l'homosexualité dans le mariage civil, alors que, sur leur territoire, aucune forme de mariage alternative n'est tolérée.
Le mariage religieux est-il une forme de mariage alternative au mariage civil ? Si oui, en quoi consiste cette alternative au regard du mariage entre personnes de même sexe ? Est-elle envisageable en France ?Telles sont les trois questions auxquelles nous nous proposons de répondre dans le présent article.
En Europe, le mariage religieux est déjà une alternative au mariage civil
Tous les États distinguent la cérémonie de mariage et l'acte de mariage
Avant la révolution du mariage entre personnes de même sexe, les débats qui pouvaient avoir lieu à propos du mariage ne portaient pas sur sa définition. On le sait, la plupart des États de l'Union européenne n'ont pas inscrit dans leur Constitution ni leur législation une définition explicite du mariage comme « union d'une femme et d'un homme ». De l'avis général, cette omission n'exprimait pas une indifférence sur le sujet, plutôt un sentiment d'inutilité, tant cette définition paraissait aller de soi.
Les débats portaient sur les divers effets du mariage, et sur les autres types d'union, PACS et union libre, quels droits pour eux ? Dans ce contexte, un point au moins paraissait acquis : le mariage était la seule union qui donnait lieu à la célébration d'une cérémonie dite « de mariage », et cette cérémonie précédait « l'acte de mariage » proprement dit, c'est-à-dire l'inscription de la femme et du mari dans les registres de l'état civil - sous l'appellation exclusive de femme « mariée » avec tel homme, et d'homme « marié » avec telle femme. La cérémonie donnait son sens au mariage ; l'acte lui donnait ses effets : une répartition des rôles que le mariage entre personnes de même sexe n'a pas modifiée.
Or, dans une majorité d'États de l'Union européenne, la cérémonie pouvait être - et est encore aujourd'hui - indifféremment civile ou religieuse ; l'édifice où se déroulait la cérémonie pouvait être - et est encore aujourd'hui - indifféremment une mairie (ou lieu équivalent) ou un lieu de culte.
Une minorité d'États seulement imposent à leurs citoyens la forme civile du mariage, et parmi eux, une minorité dans la minorité interdit tout mariage religieux non précédé d'un mariage civil.
Dix-huit États reconnaissent les mariages religieux
1°/ Une majorité d'États accordent à leurs ressortissants le droit de se marier seulement à l'Église. En ce cas, mariages civils et mariages religieux ont une valeur équivalente, et produisent les mêmes effets. Ces États sont : Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Royaume-Uni, Suède.
2°/ II est remarquable que ces pays permettant de se marier religieusement offrent cette possibilité non seulement à la religion dominante, mais aussi à de nombreuses autres confessions, mêmes minoritaires.
Par exemple en Italie, le mariage religieux catholique (dit concordataire), n'est pas seul admis par la loi. L'officier d'état civil est tenu de donner l'autorisation des cérémonies religieuses aux autres communautés chrétiennes et hébraïques qui ont passé des accords avec l'État italien. D'autres religions minoritaires peuvent aussi obtenir cette autorisation. En Espagne, un accord conclu en 1979 avec le Saint-Siège, a permis le mariage catholique. Puis des accords de coopération avec les fédérations évangéliques, israélites, puis avec la commission islamique d'Espagne, ont été approuvés par plusieurs lois en 1992. En Grèce, où le mariage civil a été instauré en 1982, il ne coexiste pas seulement avec le mariage orthodoxe très majoritaire, mais aussi avec les autres cultes « connus » selon les termes de la loi.
Le pluralisme religieux que l'on constate dans ces pays est d'une certaine façon le résultat de l'histoire. Notamment dans la péninsule ibérique, coexistaient avant la fin du XVe siècle les populations chrétiennes, islamiques et juives. Dans un esprit de fédération, le mariage confessionnel des membres de chacune de ces communautés religieuses, même minoritaires, a été toléré, les mariages chrétiens (mozarabes) ont été validés en territoires arabes, de même pour les mariages juifs et musulmans en territoires chrétiens (Mudejares).
La Grèce a été annexée par l'Empire ottoman à partir de 1453 jusqu'au début du XIXe siècle. Pendant ces presque quatre siècles, grâce à une tolérance mutuelle, les rites de la religion orthodoxe ont été maintenus, les mariages célébrés sous cette forme avaient valeur civile. On retrouve de nos jours, dans les lois les plus récentes, cette tradition de diversité des mariages.
Dans les pays baltes qui ont subi nombre d'invasions dont la plus récente est celle de l'occupation communiste, la religion a permis au peuple de résister à l'envahisseur, et le plus souvent de rester uni. Durant la période soviétique, l'Église catholique a aidé les Lituaniens à préserver leur identité nationale, de nos jours le mariage catholique coexiste dans ce pays avec le mariage civil, ainsi que celui des communautés religieuses minoritaires reconnues par l'État.
3°/ Les pays de Common Law s'attachent plus à protéger les personnes qui vivent en couple, qu'à la manière dont elles contractent mariage. En Angleterre, c'est le rite de l'Église anglicane qui domine, mais on peut se marier aussi selon des rites « non conformistes », c'est-à-dire ceux des Églises chrétiennes ou évangéliques, ou encore selon les cérémonies d'autres religions, notamment celle Israélite. Naturellement le mariage peut n'être que civil.
L'essentiel est d'obtenir de l'officier de l'état civil, le registre, un certificat d'autorisation de
se marier.
De même dans les pays nordiques - Danemark, Finlande, Lettonie, Suède - où la religion
dominante est l'Église évangélique luthérienne, on se marie dans les paroisses ou dans les
mairies.
4°/ D'une manière générale, les États européens ayant adopté le système dual - mariages civils et mariages religieux - le font sous deux séries de conditions : d'une part, les Églises sont, d'une manière ou d'une autre, expressément habilitées, et d'autre part elles doivent respecter les conditions de fond exigées par le pays, portant notamment sur l'âge des mariés et la réalité de leur consentement.
Une condition essentielle est aussi la transcription du mariage sur le registre de l'état civil, soit directement, soit par transmission par le ministre du culte de l'acte de mariage à l'officier d'état civil. L'omission de cette obligation peut être sanctionnée par l'inexistence du mariage.
5°/ La prééminence du droit civil sur le droit religieux, respectée dans tous ces États, conduit à définir le mariage religieux comme une alternative légale au mariage civil ; mais, en pratique, les mariages religieux jouissent encore d'une forte popularité, si bien que le mariage purement civil peut y être plutôt considéré comme une alternative aux mariages religieux, et non l'inverse. Il apparaît comme un gage supplémentaire de respect du pluralisme, offert par l'État aux couples qui ne se reconnaissent dans aucune religion. Ainsi se révèle une sorte de continuité historique remarquable : là où les gouvernants ont su voir dans la cohabitation pacifique des religions un facteur d'intégration de populations diverses, la coexistence de plusieurs formes de mariage, religieuses et civile, demeure un des ciments du « vivre ensemble ».
Six États réservent les effets civils aux mariages civils, mais tolèrent les mariages religieux
L'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, la Hongrie, les Pays-Bas et la Slovénie réservent au
mariage civil l'exclusivité des effets civils du mariage, ils ne reconnaissent aucune valeur
aux mariages religieux, ces derniers sont inexistants selon la loi.
Toutefois, dans ces États, les mariages religieux ne sont nullement interdits. Des couples
vivant maritalement ont donc la possibilité de se marier religieusement. Leur mariage ne
sera pas validé par l'État, mais aussi bien ils pourront jouir de certains effets accordés aux
concubins. Dans des cas extrêmes, le mariage religieux pourra faire preuve de la date de
l'« union » et faire acquérir des droits quasiment identiques à ceux du mariage.
Le cas de l'Allemagne est particulièrement intéressant en ce que l'exclusivité du mariage civil y a été introduite en 1798 par la révolution française. Ensuite, ce régime autoritaire a été maintenu par la Prusse en 1815, puis par le gouvernement de Bismarck et les suivants, et ce jusqu'à la réunification de l'Allemagne en 2000. Pendant toute cette période, il a été interdit de célébrer un mariage religieux avant le mariage civil. Mais depuis la réforme de la loi sur l'état civil entrée en vigueur le 1er janvier 2009, cette interdiction est levée. Malgré un contexte globalement défavorable aux religions en Allemagne de l'Ouest, l'allégement du carcan imposé aux mariages religieux est apparu comme une mesure indispensable pour accompagner la levée du joug athée qui pesait sur l'Allemagne de l'Est.
Quatre États interdisent totalement le mariage religieux sans mariage civil préalable
Après le premier pas accompli par l'Allemagne pour rejoindre le camp des États tolérants,
quatre États se distinguent encore par une législation du mariage à laquelle on ne peut
trouver d'autre explication que celle d'une méfiance policière envers les religions,
systématiquement soupçonnées d'entretenir au sein des cellules familiales une opposition
à l'égard du pouvoir en place.
Ces États sont la Belgique, la France, le Luxembourg, et la Roumanie. Comme l'Allemagne
jusqu'en 2009, ils imposent le mariage civil en préalable à toute union religieuse.
En France, comme on le sait, la valorisation du mariage civil date de la Révolution qui a
dénié toute valeur au mariage religieux. Pour briser définitivement la prédominance du
mariage religieux catholique, la loi du 18 germinal an X a interdit aux prêtres de célébrer
des mariages religieux sans que n'ait été présentée une preuve du mariage civil préalable,
sous peine de sanctions pénales.
Depuis longtemps, ceux-ci ne se risquent plus à enfreindre la loi du mariage civil préalable,
mais les diverses tentatives pour dépénaliser les sanctions ont échoué, et l'infraction
existe toujours dans les termes de l'article 433-21 du Code pénal « Tout ministre d'un culte
qui procédera, de manière habituelle, aux cérémonies de mariage sans que lui ait été justifié
l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil sera puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». Il suffit que deux mariages aient été célébrés
pour que la sanction pénale soit encourue.
En Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg l'interdiction de célébrer des mariages
religieux avant les mariages civils est également assortie de sanctions pénales. Toutefois,
celles-ci semblent être tombées en désuétude.
En conclusion, le tableau qui vient d'être présenté sur la situation respective des formes civiles ou religieuses du mariage dans l'Union européenne démontre une réalité rarement évoquée en France : une minorité d'États seulement imposent à leurs citoyens de regarder le mariage comme une « affaire d'État ». Dans la majorité, le mariage a conservé le meilleur des aspects qu'il a acquis au cours des Temps modernes : il est d'abord une « affaire de conscience » entre les époux et pour les époux - le rôle des États étant seulement d'assurer à leurs ressortissants la libre jouissance de l'exercice de leur droit.
Face au mariage entre personnes de même sexe, le mariage religieux garantit la liberté de conscience
C'est précisément la gravité des questions de conscience soulevées par le mariage entre personnes de même sexe qui rend très décevante, à première vue, la répartition des pays ayant adopté ce type de mariage entre les trois catégories d'États que nous venons de présenter. Plus d'un tiers des États tolérants (sept sur dix-huit) a déjà adopté le nouveau mariage : Angleterre, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Portugal, Suède. Dans le groupe intermédiaire, un tiers des États : la Slovénie et les Pays-Bas (qui se sont illustrés de manière éclatante, puisqu'ils ont été le premier État dans le monde à légiférer en ce sens). Sans trop de surprise enfin, la quasi-totalité des États les moins tolérants (trois sur quatre : Belgique, France, Luxembourg, avec l'exception de la Roumanie) a imposé le mariage entre personnes de même sexe.
On aurait pu espérer que des États ayant une longue tradition de recherche d'une coexistence harmonieuse entre des populations divisées s'abstiendraient de prendre le risque de créer de nouveaux désaccords. Mais, à la réflexion, une autre vision s'impose. Ces États ont d'autant plus facilement cédé aux pressions en faveur du nouveau type de mariage qu'ils ont eu la possibilité de ne pas l'imposer à l'ensemble de leurs citoyens, dans la mesure où les Églises, responsables de l'organisation des mariages religieux, conservent la possibilité de bénir ou de ne pas bénir des unions entre personnes de même sexe. À côté du mariage civil, désormais légalement ouvert aux personnes de même sexe, les religions et les mariages religieux peuvent apparaître comme des « terres d'asile » pour l'objection de conscience.
Pourquoi le mariage entre personnes de même sexe heurte nos consciences
1°/ L'idée d'un droit à l'objection de conscience face au mariage entre personnes de même
sexe sera difficilement comprise en France.
Car les péripéties qui, dans notre pays, ont accompagné l'adoption de la loi du 17 mai 2013,
risquent de faire disparaître pour longtemps l'association entre les termes « mariage » et
« conscience ».
On sait notamment qu'au cours des débats parlementaires, M. François Hollande, président
de la République, avait solennellement déclaré, le 20 novembre 2012, devant le Congrès
des maires de France qu'il entendait bien « que la loi s'applique pour tous, dans le respect
néanmoins de la liberté de conscience». Mais, dès le 21 novembre, il recevait précipitamment
les leaders de la toute-puissante mouvance LGBT" et renonçait à introduire dans la loi
une clause de conscience au bénéfice des élus locaux appelés à célébrer les mariages du
nouveau type.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 2013 a validé ce choix en refusant le
droit à la liberté de conscience pour les élus locaux. Mais, pas plus que le Parlement, le
Conseil ne semble s'être sérieusement interrogé sur les convictions qui pouvaient mener un homme et une femme vers un officier de l'état civil pour lui déclarer qu'ils « veulent se prendre pour mari et femme »13.
« Se prendre pour mari et femme », n'était pas seulement prendre vis-à-vis d'une autre personne, et recevoir d'elle, l'engagement de rester fidèlement unis pour mener une vie commune. C'était aussi, dans la quasi-totalité des cas, s'engager à accueillir une ou plusieurs autres personnes comme perspective et fruit de cette union fidèle. Les deux dimensions étaient indissociablement liées : l'amour et la perspective de créer une famille, telle qu'elle est exprimée à l'art. 213 du Code civil : «Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir ». Or, il ne faut pas se le cacher, ce désir d'engendrer puis d'élever des enfants qui taraude la plupart des hommes et des femmes, et qui bénéficiait traditionnellement du soutien de la société tout entière, pose un problème insoluble dans le cas du mariage entre personnes de même sexe.
2°/Ce problème a été masqué lors des débats préparatoires à la loi du 17 mai 2013 par la focalisation sur les situations de familles déjà constituées entre personnes de même sexe. On doit désormais regarder en face la situation des « familles » de mariés de même sexe qui vont se créer dans le cadre des articles du Code civil lus au cours de la cérémonie de mariage. S'ils partagent un désir d'enfant, n'ont pas eu de vie commune antérieure avec des personnes de l'autre sexe, et restent fidèles l'un à l'autre, y compris sur le plan sexuel, comment les enfants vont-ils leur advenir ?
En réalité, les limites de l'adoption étant connues, les « couples » de femmes espérant un enfant sans conjoint/homme n'auront pas d'autres possibilités que le recours aux services d'un ami, ou une rencontre anonyme, et enfin plus nouvellement, malgré son interdiction en France pour l'instant, cette opération d'achat d'enfant sur catalogue qu'est la procréation médicalement assistée sans nécessité médicale (avec les dérives eugénistes dont personne ne semble se préoccuper). Par l'une ou l'autre de ces pratiques l'enfant ne connaîtra pas son père, par le seul effet de la volonté des mères-épouses.
L'enfant ne connaîtra pas sa mère non plus lorsque, pour satisfaire son désir d'enfant, un couple, le plus souvent d'hommes, aura eu recours à la gestation pour autrui, belle expression pour exprimer la mise à disposition de son corps par une femme, au profit exclusif d'un couple non procréatif. Cette « location » de ventre de femme, en contrepartie de discrets avantages pécuniaires, est la négation même de la femme égale de l'homme. Celle-ci, nécessairement pauvre, va porter l'enfant à ses risques et périls, partager son sang et ses gênes, pour au bout du compte l'abandonner selon les termes du contrat.
Cette femme n'a pas de choix contrairement à ce qui est avancé par certains, ce qui est en jeu pour elle, c'est de gagner quelque argent, pour son foyer ou pour sa famille, au détriment de son propre corps qui appelle l'enfant de ses vœux, mais qu'elle devra abandonner. La femme qui vend son petit pleure l'enfant perdu.20
Les désordres de la marchandisation de l'enfantement mettent en péril deux familles, celle de la mère qui a porté l'enfant, et celle de la mère dite d'intention : « Qu'est devenu notre frère ? Notre sœur ? », «Tu m'as acheté ? Combien ? Où est ma mère ? »21. Ou bien l'enfant acheté ignorera la femme qui lui a donné la vie, parce que sa famille lui aura appris à ne respecter que le Dieu Argent qui satisfait tous les désirs, y compris ceux du mystère ou de la magie de la procréation.
En résumé, le mariage entre personnes de même sexe introduit dans la notion de mariage des finalités qui sont contradictoires (filiation sans parent), mais surtout qui ne peuvent se réaliser sans porter atteinte à des principes que l'on croyait acquis à jamais après les horreurs des siècles passés : la prohibition de l'eugénisme et l'abolition de l'esclavage.
3°/ On reste stupéfait que de telles évidences n'aient retenu l'attention que d'un petit nombre de responsables et de commentateurs. L'explication de ce déni de réalité doit sans doute être recherchée dans la voie indiquée par M. François Hollande. Le 24 avril 2013, juste après l'adoption de la loi par le Parlement, il déclarait : « Cette réforme va dans le sens de l'évolution de notre société. Je suis sûr qu'elle en sera fière, dans les prochains jours ou plus tard, parce que c'est une étape vers la modernisation de notre pays ».
Au-delà de la question du mariage, c'est en fait toute une conception de l'avenir de l'humanité qui s'exprime : une humanité dans laquelle les progrès des sciences biomédicales auraient mis à la portée de toutes les classes moyennes la fabrication artificielle de la vie humaine. Certes, cette échéance apparaît encore lointaine, mais en attendant, il faut tenir, semer des jalons, passer des caps difficiles. Les femmes esclaves de la gestation pour autrui et les enfants fabriqués pour devenir orphelins ne sont que les victimes provisoirement nécessaires de cette révolution en marche.
Le système de pensée et de valeurs qui l'inspire porte déjà un nom : le « transhumanisme ». Face à lui se développent d'autres systèmes de pensée et de valeurs : les uns récents, tels que « l'écologie humaine »23, les autres beaucoup plus anciens, ce sont les religions. ,
Transhumanisme ou religion : le droit de choisir
1 "/ Le transhumanisme est un système intellectuel encore peu connu du grand public, et qui ne traite pas spécifiquement des questions de mariage. Il se situe dans le prolongement d'autres systèmes mieux connus (utopisme, positivisme, biologisme, etc.), mais il est promis à un grand avenir parce qu'il s'appuie, d'une part, sur la rapidité extraordinaire des développements accomplis au cours des vingt dernières années, dans le domaine de l'intelligence artificielle grâce à l'informatique, et d'autre part, sur des moyens financiers gigantesques Son objectif est la maîtrise du vivant et la création d'un être humain « augmenté » par les machines.
Le mariage entre personnes de même sexe est apparu en même temps que le transhumanisme faisait se lever à l'horizon la possibilité d'une fabrication artificielle des enfants. Et avec elle, la réalisation du vieux rêve athée de la reproduction des hommes sans le concours de la nature créée par Dieu.
2°/ On n'évoquera ici qu'un seul des systèmes de pensée alternatifs au « transhumanisme » : la religion chrétienne, et particulièrement la religion catholique.
Les religions s'opposent au transhumanisme sur tous les points importants qui se déduisent de l'existence de Dieu. Parmi ceux-ci, figure le pouvoir exclusif de Dieu de fabriquer des hommes «à son image». Ce pouvoir est refusé aux hommes, pour qui tout être humain créé est d'abord « un autre », le sujet d'une altérité imprescriptible qui fonde la liberté humaine. Et qui s'exprime notamment dans le mariage religieux.
C'est ainsi que le Code de droit canon de l'Église catholique, dans sa version de 1983 actuellement en vigueur, définit le mariage comme l'alliance « par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants » (c. 1055 § 1 ). L'altérité sexuelle ne se discute pas, c'est notamment la condition sine qua non du mariage, l'union ne peut exister que dans la différence et la complémentarité. Cette richesse inestimable pour le bien de l'homme et de la femme leur permet aussi d'être féconds, d'avoir une descendance.
Pour contracter une telle union, l'Église exige le consentement totalement libre des époux. Rappelons qu'elle a lutté contre les mariages forcés, et que le mariage chrétien, dont les formes ont varié dans le temps, a toujours défendu la liberté des sentiments amoureux.
Toutefois, l'amour réciproque des futurs époux doit s'accompagner d'assez de maturité, de discernement, de capacité aux relations interpersonnelles, pour que le mariage soit librement contracté. C'est ainsi que les incapacités du droit canon sont plus nombreuses que celles du droit civil ; elles peuvent aboutir à l'annulation du mariage si notamment l'un des époux n'est pas apte à assumer les obligations essentielles du mariage, en ce cas les consentements n'auront pas été échangés librement.
La fidélité et l'indissolubilité sont les autres éléments de fond essentiels. Le Christ a affirmé le principe du mariage indissoluble : « Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni » (Mt 19 6; Me 10 9; Le 1618).
Mais la richesse de l'altérité peut être aussi une épreuve lorsque les caractères des époux sont trop éloignés. Il est des moments où l'amour s'enfuit ; les tentations, l'épuisement, le découragement ou toute autre cause peuvent rendre le mariage très difficile. Mais pour autant, le lien n'est pas rompu, il n'y a pas de place dans le mariage catholique pour le « divorce pour altération définitive du lien conjugal ». Les époux puisent leur force dans la certitude qu'il y a dans l'autre une étincelle, un morceau de Dieu, et qu'ils doivent poursuivre le chemin commencé sans le délaisser ni le rejeter. Le chrétien ne doit pas se replier sur lui-même et sa propre souffrance, il doit regarder l'autre avec le même amour que celui que Dieu porte sur tous les humains.
II s'ensuit un élan pour s'ouvrir à la patience et à la générosité, pour s'efforcer de comprendre et au besoin de pardonner. Cela ne se fait pas seul, mais avec l'aide de Dieu et du sacrement que l'on a reçu lors de l'échange des consentements. Et c'est devant le prêtre, les témoins et éventuellement leur famille et leurs amis que les futurs époux échangent leur consentement, car précisément le mariage catholique n'est pas clandestin.
3°/ II n'y a donc rien dans le mariage catholique français qui soit nuisible, ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs.
Au même titre que la conception transhumaniste du mariage, la conception religieuse présente toutes les conditions posées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme pour être protégée par l'article 9 de la Convention du 4 novembre 1950 : elle atteint « un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance », elle est liée « à un aspect grave et important de la vie et de la conduite de l'homme » et elle peut être jugée digne de protection dans une société démocratique européenne. Comme les pacifistes, les athées, les végétaliens ou encore les communistes, les citoyens français qui s'opposent au mariage entre personnes de même sexe en raison de ses conséquences pour l'humanité et de leurs convictions religieuses doivent donc pouvoir bénéficier de la liberté de conscience garantie par la Convention européenne des droits de l'homme. Pour répondre à cette exigence, même si la Cour européenne n'a pas encore reconnu un droit au mariage religieux, l'abrogation de l'article 433-21 du Code pénal et l'ouverture à tous les Français d'un libre accès au mariage religieux constitueraient aujourd'hui les mesures les plus appropriées et les plus faciles à prendre.
Une solution pour la France
L'abrogation de l'article 433-21 du Code pénal
L'instauration d'un libre accès au mariage religieux en France suppose une première mesure législative : la dépénalisation du mariage religieux sans mariage civil, c'est-à-dire l'abrogation de l'article 433-21 du Code pénal. Cette mesure a déjà fait l'objet dans le passé de plusieurs propositions législatives, ainsi que d'amendements lors de la discussion du projet de loi de 201329.
Bien que cette sanction soit contraire à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, aucune suite n'a été donnée jusqu'à présent, sous l'effet d'un vieux réflexe anticlérical. La présentation de cette mesure comme le préalable d'une réforme globale devrait permettre au Parlement de la voter sans peine, dès lors que le principe de cette réforme aura été expliqué, compris et adopté.
L'extension au mariage religieux des effets du mariage civil
1°/ Le cœur de la réforme sera donc l'extension au mariage religieux des effets du mariage
civil.
Une telle révolution législative n'a pas encore fait, à notre connaissance, l'objet de
propositions concrètes. C'est pourquoi, nous présentons en annexe une ébauche de
description des procédures proposées et quelques réflexions sur leur impact.
2°/ Pouvoir du législateur.
La décision rendue par le Conseil constitutionnel sur la loi ouvrant le mariage aux personnes
de même sexe a eu au moins le mérite d'établir que le législateur avait les mains totalement
libres pour agencer à sa guise les règles relatives au mariage. Ni la Constitution, ni aucun
principe constitutionnel, ni même l'appréciation du juge constitutionnel ne peuvent barrer
sa route.
Cependant, le fait que les nouvelles procédures proposées passent par des lieux de culte,
fassent intervenir des ministres des Cultes, peut soulever des interrogations sur le respect
du caractère laïc de la République française. Il convient donc d'apporter immédiatement les
apaisements nécessaires.
3°/ Application de la Convention de New York et principe de laïcité. La réforme proposée s'inscrira dans le respect le plus strict de la convention de New York du 10 décembre 1962 sur « le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages », et notamment de son article 1er - al.1 : «Aucun mariage ne pourra être contracté légalement sans le libre et plein consentement des deux parties, ce consentement devant être exprimé par elles en personne, en présence de l'autorité compétente pour célébrer le mariage et de témoins, après une publicité suffisante, conformément aux dispositions de la loi ».
Ce texte place l'expression du libre consentement des époux au centre de toute la procédure de mariage : elle est le moment crucial d'une célébration publique à laquelle participent les époux eux-mêmes, bien sûr, mais aussi une « autorité compétente » et des témoins. Comme on l'a vu précédemment, cet échange public des consentements est le moment solennel où les époux affirment le sens de leur union.
En France, une telle description s'applique non seulement à tous les mariages célébrés en mairie, mais aussi aux mariages célébrés dans des églises, temples ou synagogues. La réforme consistera simplement à considérer les prêtres, pasteurs et rabbins comme « autorités compétentes » au sens de l'article 1er de la Convention, ainsi que le font tous les pays européens tolérants.
Le fait de considérer les prêtres, pasteurs et rabbins comme « autorités compétentes » au sens de l'article 1er de la Convention de New York ne signifie nullement la reconnaissance par la République des Cultes catholique, protestant ou juif. Il s'agit seulement ici de reconnaître aux ministres des cultes la qualité de témoins crédibles d'événements - les échanges libres des consentements - que l'officier de l'état civil n'aura pas constatés par lui-même. Ce n'est pas parce que les mariages religieux ont, aux yeux de tous les croyants qui y participent, une signification surnaturelle, qu'ils ne donnent aucune prise à la nature : des comportements se manifestent, des gestes s'échangent ; c'est de ces événements naturels, et de ceux-là seulement, que les ministres des Cultes rendront compte aux officiers de l'état civil. L'autorité déléguée par l'État ne servira ni à confirmer ni à infirmer les croyances des époux ; les ministres des Cultes auront seulement pour mission de s'assurer que les époux ont extériorisé leur consentement selon les exigences de l'autorité supérieure située à l'extérieur du lieu de culte, c'est-à-dire l'État.
Ces témoins privilégiés seront, en quelque sorte, accrédités en raison de leur discernement, mais seulement pour remplir une mission factuelle. Le Code civil traite déjà de cette manière les divers professionnels de santé qui interviennent pour déclarer les naissances ou les décès. L'État ne fait alors pas de distinction selon le statut public ou privé des professionnels.
Comme l'écrit un auteur, « La loi de 1905 ne met pas fin aux relations de l'Église et de l'État : elle en ouvre un nouveau chapitre dans des conditions redéfinies. Désormais, leurs relations passent du droit public au droit privé (au sens classique de cette division). A ces personnes ou associations privées, l'État peut (...) confier des missions de service public : en aucun cas, d'aucune manière, ces décisions ne leur confèrent les attributions et prérogatives de la puissance publique »33. La mission qui serait confiée aux ministres des Cultes de « célébrer » des mariages (au sens de la convention de New York), se situerait bien dans ce cadre, puisqu'il n'est pas proposé de considérer les prêtres, pasteurs et rabbins comme « autorités compétentes » au sens de l'article 3 de la Convention : « Tous les mariages devront être inscrits par l'autorité compétente sur un registre officiel». L'inscription des actes de mariage au registre de l'état civil demeurera une compétence exclusive des services municipaux de l'état civil, et il appartiendra au ministère de l'Intérieur d'en définir les modalités.
4°/ Respect des lois qui intéressent l'ordre public.
La distinction opérée entre la cérémonie de mariage et l'acte de mariage aurait aussi pour
effet de garantir le respect des lois d'ordre public. Les contrôles effectués par l'officier de
l'état civil en amont de la cérémonie permettraient d'écarter d'emblée trois effets possibles
du mariage impliqués par certains rites religieux.
Il s'agit, concernant les époux de confession catholique, de la vocation à l'indissolubilité du
mariage prévue par le droit canonique. En effet, le principe d'indisponibilité des personnes
limite la liberté contractuelle, il interdit l'engagement formel des époux « à perpétuité ». Une
telle disposition écrite ne pourrait qu'être sanctionnée, comme contraire à l'ordre public,
article 6 du Code civil. Nonobstant la célébration religieuse du mariage, les époux auront le
droit de divorcer selon les lois civiles en vigueur, sans avoir à solliciter l'autorisation d'une
autorité ecclésiastique.
D'autre part, le droit musulman admet encore la bigamie, bien qu'elle soit en recul dans
les pays d'Afrique du Nord, ainsi que la possibilité de répudier l'épouse, deux notions
également contraires aux lois qui intéressent l'ordre public.
Concernant la bigamie, si le mariage est célébré à l'étranger, dans un État qui la tolère, l'État
français ne donnera aucune valeur au mariage célébré après un premier non encore dissout.
Si d'aventure un tel mariage était par erreur célébré en France, il serait frappé de nullité
absolue, comme contraire à l'ordre public, selon l'article 147 du Code civil et l'article 433-20
du Code pénal ; sauf la possibilité pour la seconde épouse de soumettre à l'appréciation du
tribunal la question de la putativité de ce mariage à son égard.
Enfin, le droit à la répudiation de l'épouse, prévu sous conditions par le droit musulman,
est invalide en France, en raison notamment de l'inégalité qu'il implique entre les époux.
Tous les époux français mariés selon le rite musulman ont droit à la procédure de divorce en vigueur sur le territoire, et notamment les épouses, écartant ainsi le droit musulman. Notons que le législateur sera loin de se sentir en terre inconnue pour exercer les discernements nécessaires face aux effets éventuellement indésirables des mariages religieux. En effet, la France valide déjà des mariages religieux, dès lors qu'ils sont célébrés hors de son territoire, dans les termes de l'article 171 -1 du Code civil : « Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration... ».
Il s'agit de l'application d'une notion dite de « l'effet atténué de l'ordre public » et ainsi, ce qui serait illégal en France sera validé du seul fait que cela s'est produit à l'étranger, avec l'approbation de la loi étrangère. Pour peu que les conditions de fond élémentaires du mariage aient été respectées, touchant notamment à la réalité du consentement et au respect des interdits (âge, inceste...), le mariage célébré hors de France est « sauvé ».
5°/ Désignation des religions bénéficiaires de la réforme.
Un dernier point, toutefois, peut soulever une difficulté. Comment établir la liste des
religions dont les ministres recevront délégation de l'État pour célébrer des mariages ayant
un effet civil ?
Cela a été réglé par tous les États tolérants, selon des méthodes diverses, mais en faisant
souvent une distinction entre les religions « traditionnelles » dans le pays et les religions
« nouvelles ».
On ne peut qu'espérer le même pragmatisme de la part du législateur français. Cette
attitude conduirait à appliquer la réforme sans délai aux Églises dont les relations avec l'État
sont inscrites depuis 1905 dans un cadre législatif stable : les Églises des cultes catholique,
protestant et juif. Celles-ci sont organisées, au regard de la loi civile, en associations cultuelles
reconnues par l'État et qui, étant les employeurs des ministres des Cultes, constitueront les
interlocuteurs directs des services préfectoraux.
Au demeurant, comme cela a été développé plus haut, l'expérience d'un siècle de
séparation entre ces trois Églises et l'État n'a jamais fait apparaître aucune utilisation des
mariages cultuels à des fins contraires aux valeurs républicaines. À cet égard, le passé
répond certainement de l'avenir.
Le déroulement des cérémonies de mariage par des religions qui sont encore minoritaires
en France, notamment les religions musulmane et bouddhique, exigera des mises au point
à préciser, en particulier pour l'expression des consentements des époux.
Intemporalité et universalité du mariage : «Depuis plus de sept mille ans qu'il y a des hommes
et qui aiment... », aurait pu écrire La Bruyère.
Oui, le mariage, dira-t-on, peut tout accepter d'une humanité qui change au fil des siècles et
des millénaires. Mais tous les hommes peuvent-ils tout accepter d'un mariage qui change
alors qu'eux-mêmes n'ont pas changé ? C'est là, résumée, toute l'ambiguïté de la révolution
du mariage entre personnes de même sexe.
Fondée sur l'hypothèse d'une arrivée prochaine de la fabrication artificielle des humains, elle comporte aujourd'hui des aspects qui la rendent révoltante. Le principe de précaution aurait dû conduire à la différer. Il n'en a malheureusement pas été ainsi. Mais le principe de la liberté de conscience doit conduire à respecter les opinions divergentes - lesquelles, aujourd'hui, s'expriment majoritairement dans le cadre des différentes religions pratiquées sur tous les continents. Les futurs époux et époux croyants ne doivent pas être contraints d'accepter de donner à leur mariage un sens qu'ils refusent de toute leur énergie, même s'ils en recherchent les effets.
C'est pourquoi nous invitons l'État français à franchir le pas et à reconnaître valeur civile aux mariages religieux. Il fera montre de tolérance, pour le plus grand bien des couples concernés et de leur descendance. Et il se ralliera au message, certainement conçu pour avoir valeur universelle, que vient de délivrer la Cour suprême des États-Unis d'Amérique. En conclusion de son arrêt du 26 juin 2015, Obergefell et al. v. Hodges, imposant le mariage entre personnes de même sexe sur tout le territoire fédéral, la Cour écrit : «On doit souligner que les religions, et ceux qui adhèrent à des doctrines religieuses, peuvent continuer d'affirmer avec la plus sincère conviction que, par les préceptes divins, le mariage entre personnes de même sexe ne doit pas être accepté. ..lien est de même pour ceux qui s'opposent au mariage de même sexe pour d'autres raisons. En retour, ceux qui croient que le mariage de même sexe est justifié et même essentiel, pour des raisons de convictions religieuses ou de croyances séculaires, peuvent partager leurs points de vue avec ceux qui sont en désaccord, dans un débat ouvert et constructif... ».
Passons sur les « préceptes divins » qui rangent toutes les religions du côté des fondamentalismes, et retenons l'appel à un « débat ouvert et constructif ». C'est précisément ce débat qui a fait défaut en France. N'oublions pas qu'il avait été demandé par une pétition citoyenne réunissant 700 000 signatures et adressée au Conseil économique, social et environnemental (CESE) légalement saisi pour avis ; or celui-ci a refusé de la recevoir.
Aujourd'hui, la situation est bloquée car les objections de « ceux qui continuent d'affirmer que le mariage entre personnes de même sexe ne doit pas être accepté » ne trouvent aucune enceinte pour s'exprimer. En libérant le mariage religieux, le Parlement français rattachera enfin notre pays au groupe des États tolérants, ceux qui admettent l'éventualité que le mariage entre personnes de même sexe ne soit pas, en dépit des apparences, définitivement gravé dans le marbre de leur droit positif.
[ Retour en haut de la page
↩ ]
********************